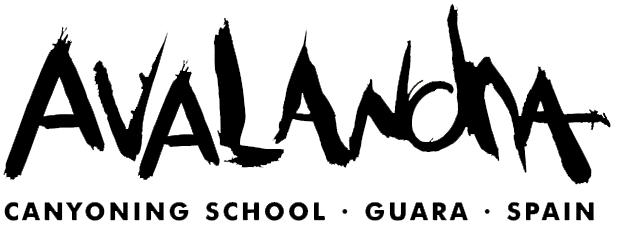Le canyoning est une activité de loisir et sportive relativement récente telle que nous la connaissons aujourd’hui. Ce n’est qu’à la fin des années 80 et au début des années 90 que le canyoning a commencé à acquérir sa propre entité, avec l’émergence de techniques et de matériaux spécifiques à cette discipline, qui ont commencé à la séparer de ce que l’on considère comme sa grande sœur : la spéléologie.
En fait, comme nous le verrons ci-dessous, ce sont les spéléologues qui ont commencé à pénétrer systématiquement dans les gorges et les canyons. Aujourd’hui encore, les deux activités ont beaucoup de points communs.
Les origines du canyoning
Bien que depuis la préhistoire , les chasseurs s’enfonçaient déjà dans des gorges profondes et étroites à la recherche ou à la poursuite de leurs proies, et que les bergers remontaient les lits des rivières à sec à la recherche d’un abri pour le bétail, il n’est pas possible de les définir comme des canyoneurs au sens où nous l’entendons aujourd’hui.
La naissance « officielle » du canyoning remonte à 1904, et est attribuée à Lucien Briet, le grand découvreur d’un grand nombre de ravins dans les montagnes des Pyrénées, et plus particulièrement dans la Sierra de Guara.
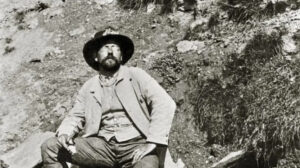
Spéléologie et canyoning
La spéléologie et le canyoning sont nés presque main dans la main.
La spéléologie a fait ses premiers pas lorsqu’Édouard-Alfred Martel et d’autres collègues sont entrés dans une rivière souterraine, dans le Languedoc-Roussillon français, près de Camprieu. Ils ont voyagé sous terre sur environ 1 300 mètres pendant 2 jours, surmontant un grand nombre de difficultés et de dangers. Cela s’est passé en 1888, et en 1895, Martel lui-même a fondé la Société de spéléologie.
Un an plus tard, en 1896, Lucien Briet rejoint la société nouvellement fondée et, avec Martel et Louis Armand , commence différentes explorations à travers les canyons et les gouffres. Mais alors que Martel et Armand se concentrent sur les cavités souterraines, Briet opte pour la recherche de ravins. Entre 1903 et 1911, Lucien Briet réalise un travail d’exploration inestimable, compilant un grand nombre de données dans les Pyrénées et, en particulier, dans la Sierra de Guara.
Les premiers parcours de canyoning « modernes »
En 1933, un groupe français composé de Cazalet, Duboscp, Mailly et Ollivier descend le canyon d’Oladibia, situé au Pays basque français. Cette descente est considérée comme le premier parcours de canyoning moderne, étant parfaitement documenté.
Au cours des années 60, un autre groupe français a commencé à faire des descentes à travers la Sierra de Guara, à Choca, Mascún et Guero, avec l’aide précieuse du travail que Lucien Briet avait accompli des décennies plus tôt.
Déjà dans les années 70, des canyoneurs comme Escribano et Santolaria prenaient le relais.
Enfin, dans les années 80 et 90, le sport a commencé à devenir populaire, ouvrant des canyons et des ravins à tout le monde.
Qu’est-ce que le canyoning ?
Le canyoning est une activité d’aventure qui consiste à descendre des ravins, des canyons et des gorges, en utilisant différentes techniques telles que la descente en rappel, le saut et les toboggans naturels. Bien que ses racines remontent aux pratiques d’exploration des spéléologues, le canyoning moderne a commencé à se différencier à la fin des années 1980, lorsque des techniques spécifiques ont été développées pour cette discipline. Il se caractérise par la combinaison de l’adrénaline des sports extrêmes avec la possibilité de profiter de la nature dans des environnements uniques et difficiles d’accès.
Sport de canyoning
Le canyoning est passé d’une activité récréative à un sport d’aventure pratiqué dans le monde entier. Au cours des années 80 et 90, le canyoning a gagné en popularité, en particulier dans des endroits comme la Sierra de Guara, où les pionniers ont établi les premiers itinéraires modernes. Ce sport combine des techniques d’escalade et de natation, adaptées aux particularités des canyons et des rivières, ce qui en fait une activité exigeante mais accessible pour différents niveaux d’expérience.